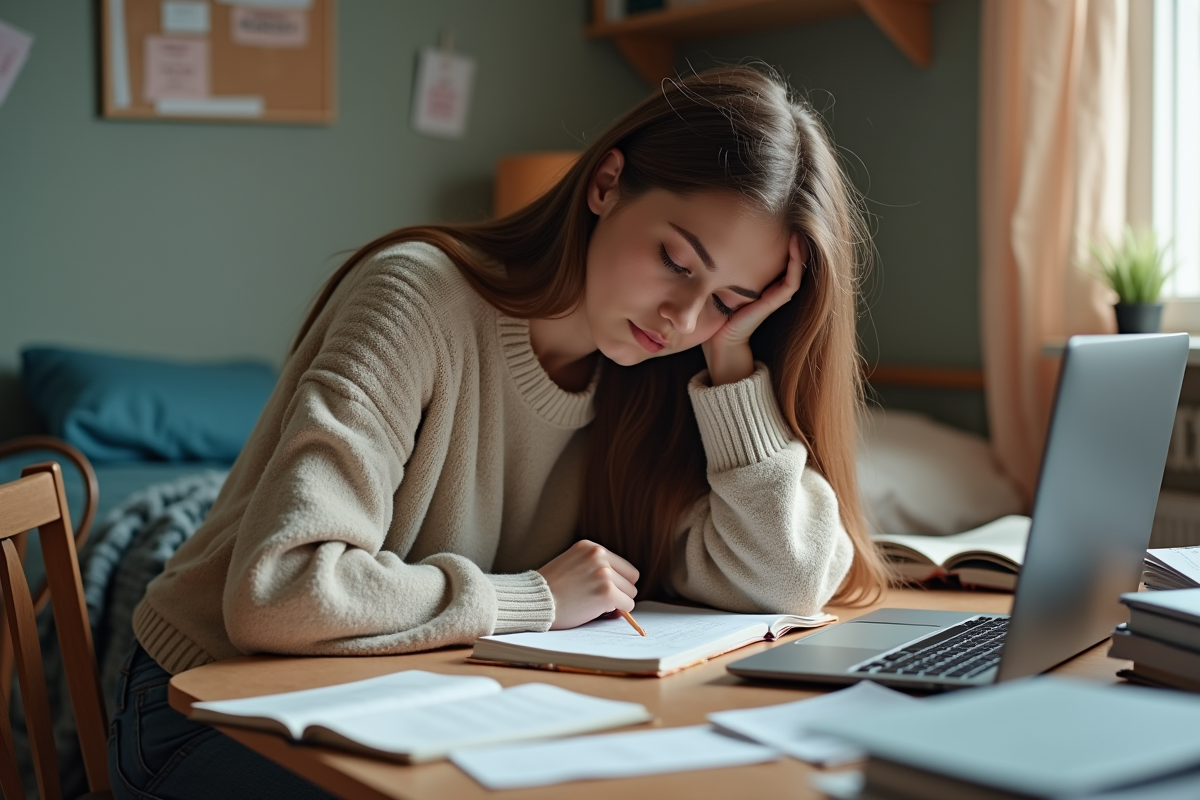Entre 2020 et 2023, le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement supérieur a progressé de 12 % en Europe occidentale, selon l’UNESCO. Dans 78 % des cas recensés, un sentiment d’inutilité ou de lassitude précède la décision d’arrêter les études, bien avant des difficultés financières ou un manque de ressources pédagogiques.Les plateformes de soutien scolaire en ligne constatent que les pics de désengagement ne coïncident pas toujours avec les périodes d’examens. Certains étudiants performants se déclarent pourtant “incapables de s’y mettre”, sans raison apparente. Ce décalage interroge sur l’origine réelle de la perte de motivation et sur les moyens concrets d’y remédier.
Pourquoi la motivation pour étudier peut-elle disparaître ?
Voir son envie d’étudier s’évaporer n’a rien d’anodin. D’un semestre à l’autre, l’énergie s’effrite parfois sans crier gare. Les signes d’un décrochage ne trompent pas : fatigue installée, travail repoussé jour après jour, difficulté à garder la concentration, voire incapacité à se rendre en cours. L’épuisement se cumule et pèse lourd. À cela viennent se greffer un stress diffus, la peur de ne pas assurer, la pression, parfois sourde, parfois explicite, de l’entourage ou de la famille. Parfois, tout simplement, l’intérêt pour les matières s’effondre. La mécanique scolaire se fait pesante, le sens file entre les doigts. Depuis l’irruption de la crise sanitaire, les témoignages sur le burn-out étudiant se multiplient, révélant à quel point l’équilibre psychique des jeunes est exposé.
Parmi les origines les plus fréquemment relevées de ce manque de motivation, on remarque surtout :
- Peur de l’échec et manque de confiance en soi
- Absence de perspectives ou d’objectifs suffisamment clairs
- Solitude ou sentiment d’isolement social
Ce que l’on mettait autrefois sur le dos de la paresse s’affiche désormais en pleine lumière : la santé mentale étudiante s’est imposée comme une préoccupation tangible. À l’heure des auditions et enquêtes, près d’un étudiant sur trois reconnaît être déjà passé par une période de démotivation persistante. Fatigue, surcharge, sentiment de ne pas compter : tout s’emmêle, et le contexte parfois perçu comme glacé, cours à distance, anonymat, absence de relais, rend l’effort encore plus ardu à fournir.
Les causes cachées derrière la paresse et le manque d’envie d’apprendre
On évoque souvent la paresse ; la réalité colle rarement à ce cliché. Que ce soit un sommeil haché, le poids du retard accumulé, l’invasion des écrans ou la pression de résultats toujours plus élevés, tout finit par grignoter la volonté. Parmi ceux qui décrochent, beaucoup avancent masqués sous la fatigue, la démotivation, ou les attentes insatiables d’un système qui compare plus qu’il n’encourage.
L’anxiété, la peur de décevoir ou de rater, la perte de repères lors d’un choc personnel, ou des difficultés comme un trouble de l’apprentissage : chaque obstacle fragilise un peu plus cette fameuse motivation. Dans plusieurs grandes villes, les équipes pédagogiques observent une démobilisation accrue dès qu’un climat social se tend ou qu’une crise surgit dans l’actualité.
Pour mieux cerner les facteurs à surveiller, on peut retenir ceux qui aggravent significativement la situation :
- Relations sociales mises à mal ou conflits persistants avec des membres du personnel éducatif
- Difficultés personnelles et troubles tels que le TDAH
- Manque d’autonomie dans la gestion des études
Les dispositifs d’accompagnement psychologique dédiés aux étudiants connaissent un usage croissant, ce n’est pas un hasard. Isolement, exigences familiales et attentes scolaires forment un cocktail rarement propice à l’apaisement. Le regard porté sur l’erreur a aussi son poids : valoriser l’effort plutôt que la note, c’est cultiver sur la durée une motivation qui n’épuise pas.
Des astuces concrètes et motivantes pour retrouver l’envie d’étudier
Redonner un souffle à sa motivation ne tient pas d’un grand bouleversement. Cela commence par une série d’ajustements faciles à saisir, alliant organisation et moments de respiration. La stabilité d’une routine simple, accessible, fait souvent des merveilles. Fractionner les tâches en étapes digestes, puis se donner des objectifs précis, mesurables et atteignables sur une période donnée : cette méthode aide à garder un cap lisible et à prévenir l’impression d’être noyé sous la masse.
Pour optimiser son temps d’étude, la méthode Pomodoro s’invite comme un allié : intervalle de 25 minutes de concentration suivies de 5 minutes de pause, une alternance qui préserve l’attention sans tirer sur la corde. Le time blocking a aussi ses adeptes : attribuer à chaque créneau une fonction spécifique limite la dispersion et aide à mieux maîtriser l’emploi du temps.
Voici quelques leviers à actionner pour réactiver sa motivation, au fil des jours :
- Se féliciter pour chaque étape franchie, même minime : la progression visible entretient la dynamique.
- Soigner son équilibre, en intégrant des activités régénérantes : musique, sport, échanges avec ses proches, tout ce qui fait respirer en dehors des révisions.
- Oser la méthode WOOP : se projeter sur le but à atteindre, anticiper les principaux obstacles, prévoir des solutions concrètes, pour ne pas rester paralysé à la première difficulté.
S’appuyer sur un coach, un tuteur ou un ami qui encourage, peut donner la force de tenir le rythme. Des compléments alimentaires, comme ceux développés par certains laboratoires, offrent parfois un coup de pouce temporaire, même si rien ne remplace le sommeil et une alimentation variée. Parfois, s’engager dans une activité associative ou prendre le temps de consulter un professionnel de santé, c’est retrouver un élan et rompre avec la spirale de l’isolement.
Quand la motivation s’essouffle, il s’agit souvent moins de “paresse” que d’un équilibre à réinventer. Un jour, l’étudiant qui doute pourrait bien transformer cette lassitude en énergie neuve, sur la seule foi d’avoir repris la main sur son parcours.